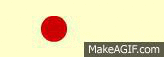Les Illusions d'Optique
TPE 2013-2014
Dans la partie dont on a parlé de la persistance rétinienne, on voit que grâce à cette capacité et aux images rémanentes, on est capable d'effectuer la fusion d'images successives et nous donnent une impression du mouvement.
Après l'enquête de la persistance rétinienne avec des jouets optiques et la naissance de la photographie en 1829 par Nicéphire Niépce et Jacques Daguerre, on arrive à la découverte du cinéma à la fin du même siècle par des frères Lumière - Louis Lumière et Auguste Lumière, qui ont inventé pour la première fois en 1895, le cinématographe (du grec ancien kínêma "mouvement", et "graphein", écrire).
Le cinéma et un peu de son histoire...
Le cinématographe fut le premier appareil optique qui permet à la fois le fonctionnement du caméra (1) et une projection sur un écran grâce à une source de lumière provient d'une boîte (2), donc d’avoir un accès à un ensemble du public, différemment aux appareils auparavant. La vitesse de projection était à 16 images par secondes
Pendant la projection des premiers films cinématographiques, le 28 décembre 1895 au Grand Café à Paris. On pouvait remarqué sur une affiche sur la porte d'entrée: « Cet appareil, inventé par MM. Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir, par des séries d'épreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédés devant l'objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant en grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran. »

Dans la vidéo ci-dessus, on voit comment ce cinématographe fonctionne. Avec les mêmes principes des jouets optiques, il s'agit une bande (dans le cinématographe la pellicule de film) des images et grâce à la persistance rétinienne, on observe une illusion du mouvement.
Mais au cours du temps, on a découvert que la théorie de la persistance rétinienne n'est pas en effet 100% l'explication de scène de mouvement du cinéma. La raison pour qu’on se pose la question est le problème de la durée normale de la persistance rétinienne qui est de 50 millisecondes soit 20 images par seconde. L’illusion de mouvement existe pour des fréquences de la norme actuelle de 24 images par seconde (décalage des images de ~ 0,417 seconde), parfois 25 images (0,04 seconde), et les dessins animés des studios Disney à 30 (~ 0,03 seconde) pour rendre ses personnages vivants et presque réels. On sait aussi que plus l’exposition de la rétine à l’image est longue et plus la persistance sera longue. Mais avec ces chiffres ci-dessus, qui sont plus petit que la durée normale de a persistance rétinienne. Par conséquent la première image n’a pas fini de persister avant l’apparition de la deuxième, ce qui cause un problème de la théorie de la persistance rétinienne pour assurer l’effet de mouvement.
Pour reprendre l’explication, on va sauter en 1912 avec la découverte de l’effet bêta par Max Wertheimer. Il s’agit de deux images légèrement décalées suivent rapidement l’une à la suite de l’autre. Lorsque une image s’éteint, l’autre se mettre en place. Notre cerveau reçoit alors automatiquement un mouvement grâce au travail d’intégration des différentes aires corticales visuelles impliquée dans la détection et l’orientation du mouvement.
L'effet bêta



Les 3 images comportées l'animation (image gif)